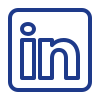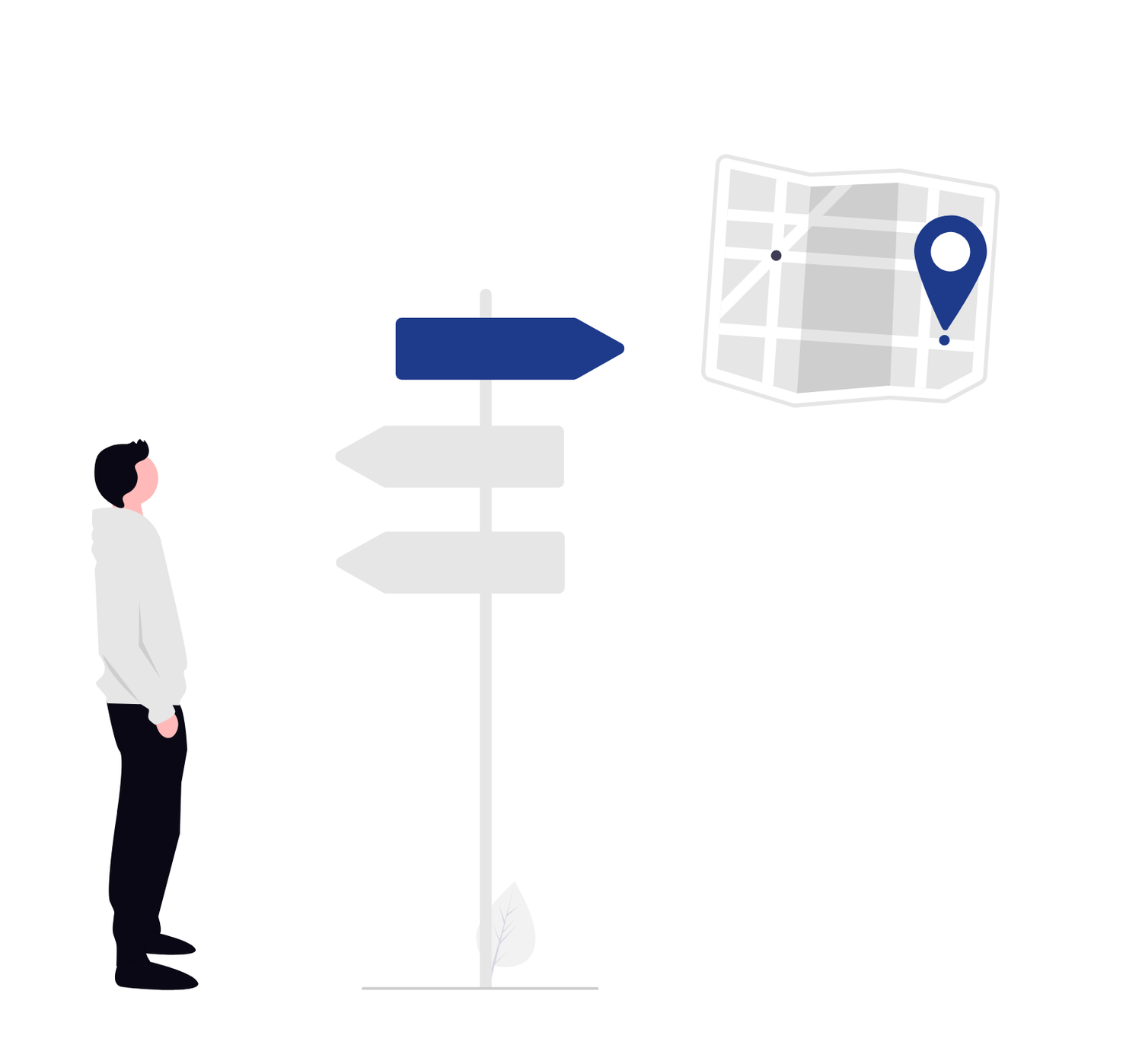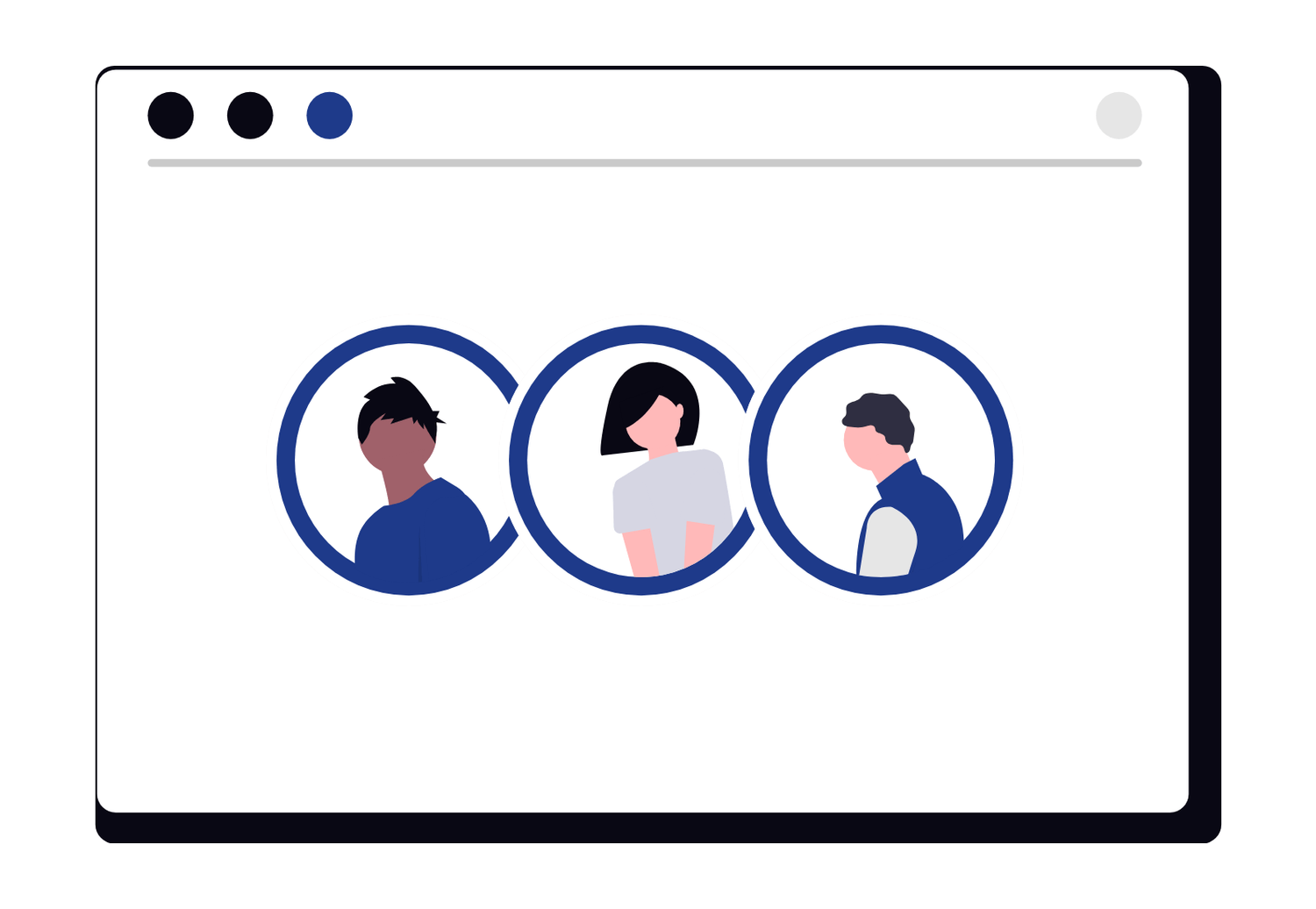La fonction publique perpétue-t-elle des stéréotypes de genre ?
Les institutions publiques sont souvent perçues comme des bastions de neutralité et d’égalité. Pourtant, les inégalités de genre y persistent, parfois de manière insidieuse.
Dans cet épisode, Émilie Agnoux interroge la manière dont la fonction publique peut (encore) reproduire des stéréotypes de genre. Comment se manifestent-ils ? Quels sont les freins à une vraie culture de l’égalité ? Et surtout, que peut-on faire pour transformer l’administration de l’intérieur ?
Présentation de l'invité : Émilie Agnoux
« Quand une femme déroge à l’attendu genré, c’est elle qu’on interroge, pas la norme. »
Émilie Agnoux est haute fonctionnaire et membre du think tank "Le Sens du service public", où elle s’investit sur les questions d’égalité femmes-hommes, de diversité et de transformation des cultures administratives. Engagée pour faire évoluer les pratiques RH dans la fonction publique, elle apporte un regard à la fois institutionnel et critique sur les mécanismes qui freinent l’égalité réelle.
Décryptage des idées clés
L’égalité ne se décrète pas, elle se vit au quotidien
Longtemps, on a cru que la fonction publique était naturellement exemplaire sur l’égalité femmes-hommes. Statuts identiques, grilles communes, même accès aux concours : le cadre semblait garantir l’équité. Mais la réalité est plus complexe. Derrière la neutralité du statut se cachent encore des écarts de rémunération, des biais dans les parcours et des réflexes de pouvoir profondément ancrés.
Dans les métiers à forte utilité sociale — l’éducation, le soin, la relation à l’usager — souvent exercés par des femmes, la reconnaissance tarde à suivre. L’égalité réelle, ce n’est pas un texte de loi : c’est une vigilance quotidienne, dans les choix de carrière, les promotions, les comportements, les mots qu’on emploie.
Le plafond de verre est fait de gestes ordinaires
Les inégalités ne se maintiennent pas par des décisions spectaculaires, mais par une multitude de petites choses : les blagues sexistes, les réunions où la parole féminine passe au second plan, les heures supplémentaires plus accessibles à ceux qui n’ont pas de charge domestique. Ces micro-écarts produisent de vrais écarts de carrière. Les femmes ne manquent pas d’ambition, elles manquent d’espace pour la déployer.
Dans les équipes, dans les réunions, dans les politiques RH, l’enjeu est d’ouvrir ces espaces — pas pour “faire de la parité”, mais pour libérer du talent. Car l’injustice fatigue tout le monde, hommes compris : elle épuise le collectif autant qu’elle invisibilise les contributions.
Changer la culture, c’est d’abord se regarder agir
Les lois ont fait avancer les choses. Mais sans changement de culture, les réflexes perdurent. Le cœur du sujet, c’est l’exemplarité : celle des cadres, des managers, de toutes celles et ceux qui ont aujourd’hui le pouvoir d’agir autrement. Remettre en cause les stéréotypes, ce n’est pas accuser : c’est s’observer. C’est se demander comment on répartit la parole, comment on valorise le travail invisible, comment on répond à une remarque déplacée.
C’est aussi se souvenir que l’égalité ne progressera pas sans les femmes, mais qu’elle ne tiendra pas sans les hommes. La fonction publique a un rôle immense à jouer : non seulement garantir le droit, mais inspirer une société plus juste, par la façon même dont elle travaille.
© 2025 Fonction Publique Mon Amour