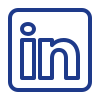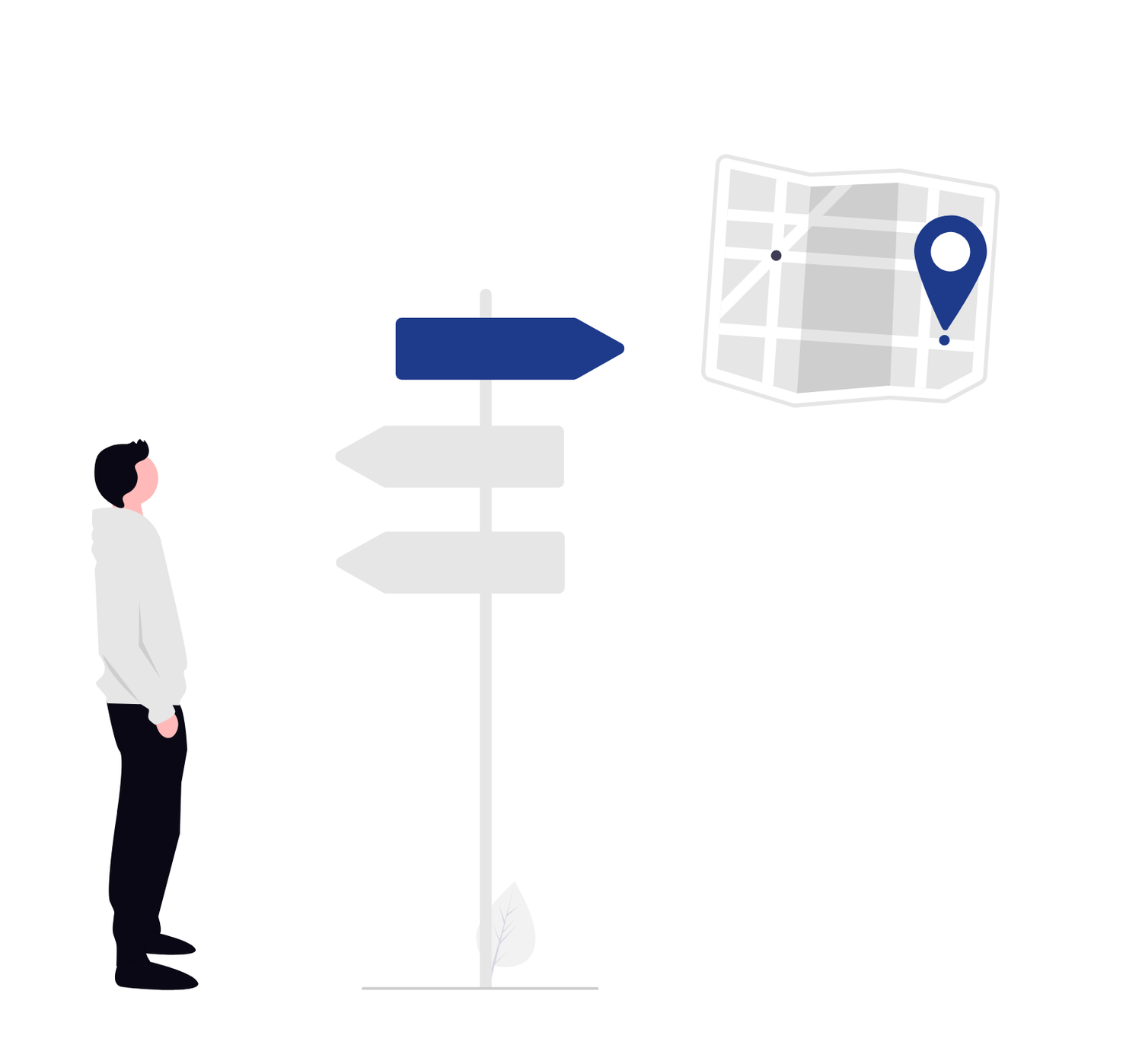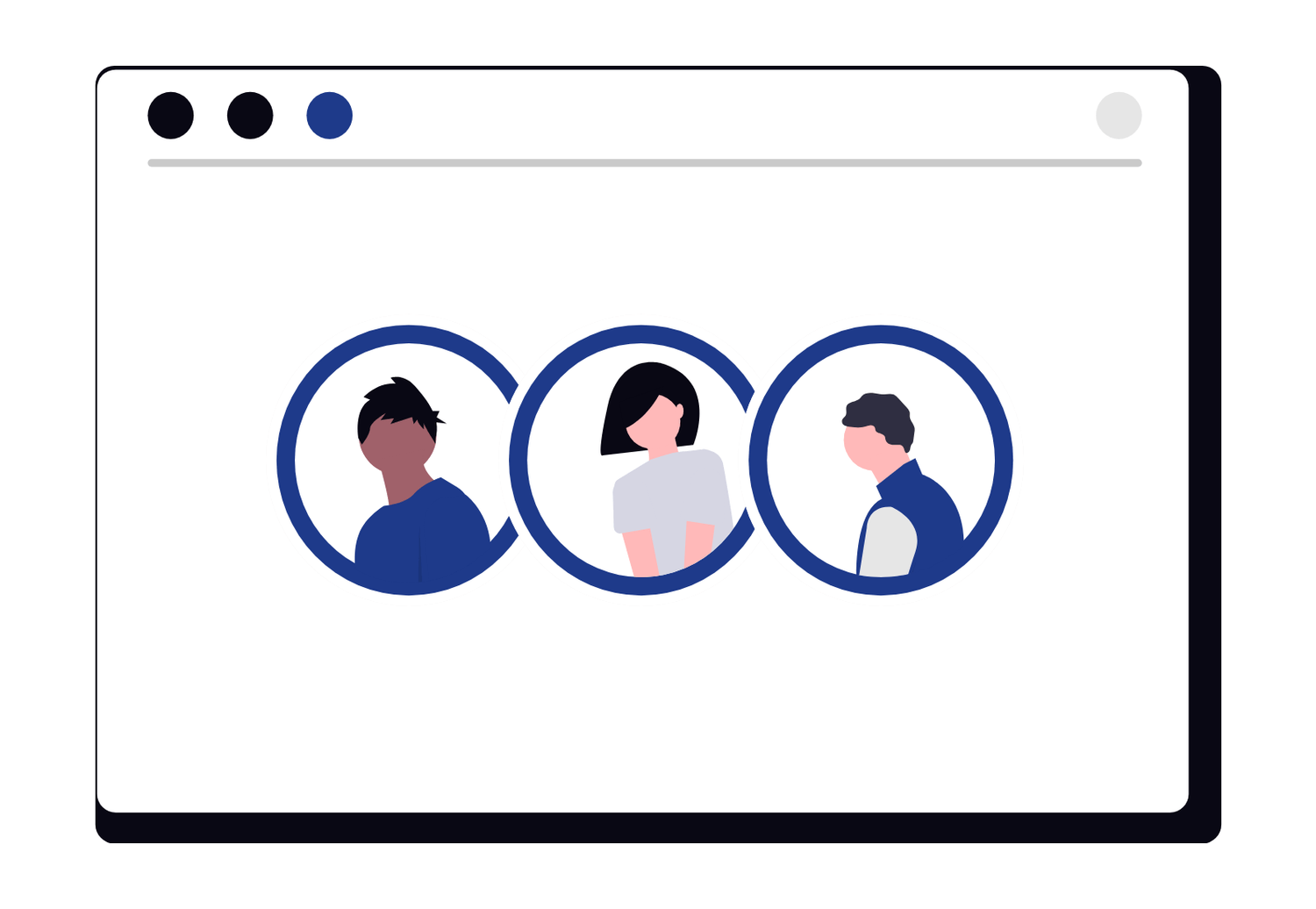Focus sur \"Trop de fonctionnaires ? Histoire d'une obsession française (XIXe - XXIe siècle)\"
(crédit photo : Anouk Desury / Light Motiv)
Pourquoi dit-on si souvent qu’il y a « trop de fonctionnaires » ? Et d’où vient cette idée persistante ? Dans cet épisode, Émilien Ruiz revient sur son travail de recherche autour de cette question, qu’il a explorée dans son livre. Une plongée rigoureuse dans deux siècles d’histoire administrative française, loin des idées reçues.
Présentation de l'invité : Émilien Ruiz
« La question n’est pas : y a-t-il trop de fonctionnaires ? Mais : pourquoi se pose-t-on toujours cette question ? »
Historien de la fonction publique, Émilien Ruiz enseigne à Sciences Po Paris. Il travaille depuis plus de vingt ans sur l’évolution du nombre de fonctionnaires en France, ses représentations et ses usages politiques. Son livre "Trop de fonctionnaires ? Histoire d'une obsession française (XIXe - XXIe siècle)" est tiré de ses recherches de thèse.
Décryptage des idées clés
“Trop de fonctionnaires” : un mythe qui use les gens, pas l’État
Ce discours ronge le moral des agents depuis des décennies. Il s’insinue dans les conversations, les dîners, les médias. Il installe une honte diffuse : celle d’avoir choisi la stabilité, celle de “coûter” à la société. Ce mythe ne décrit pas la réalité, il fabrique un soupçon permanent. Résultat : des agents qui s’excusent d’exister, qui doutent de leur utilité.
Or, la vérité est inverse. L’histoire montre que derrière chaque vague d’embauches, il y avait des besoins humains — scolariser, soigner, accompagner, protéger. Dire “trop de fonctionnaires”, c’est oublier que derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes qui tiennent, qui s’engagent, qui assument des missions que personne d’autre ne ferait.
Le poids du regard social : quand servir devient suspect
Le mythe du “trop de fonctionnaires” a transformé un choix de sens en un soupçon de paresse. Beaucoup d’agents en subissent les effets au quotidien : remarques, dénigrement, perte de fierté. Comme si la stabilité et la sécurité étaient des fautes morales. Pourtant, choisir d’être agent, c’est souvent choisir de s’impliquer dans le temps long, d’accepter des contraintes, d’endosser des responsabilités collectives que peu veulent porter.
Cette image déformée abîme la relation entre les agents et la société. Elle les empêche de parler de leur travail avec fierté, d’assumer pleinement la valeur qu’ils apportent. Il est temps de changer ce regard : non pas en réclamant de la reconnaissance, mais en reprenant le récit.
Réécrire l’histoire : remettre de la dignité dans le mot “fonctionnaire”
L’auteur montre que l’histoire du “fonctionnaire” est celle d’un mot qui a perdu sa noblesse. Il désignait autrefois un pilier du collectif, celui qui “fait fonctionner” le pays. Aujourd’hui, il est devenu une caricature. Revenir à l’histoire, c’est réentendre ce qu’il voulait dire : l’utilité, la continuité, la responsabilité envers les autres.
Les agents n’ont pas besoin d’un plaidoyer, mais d’un vocabulaire qui les respecte à nouveau. Redonner du sens au mot, c’est rendre visible l’humain derrière la fonction. Ce n’est pas glorifier l’État : c’est rappeler que sans ces personnes, rien ne tourne — ni les écoles, ni les territoires, ni les relations humaines qui tiennent la société debout.
© 2025 Fonction Publique Mon Amour