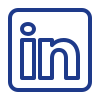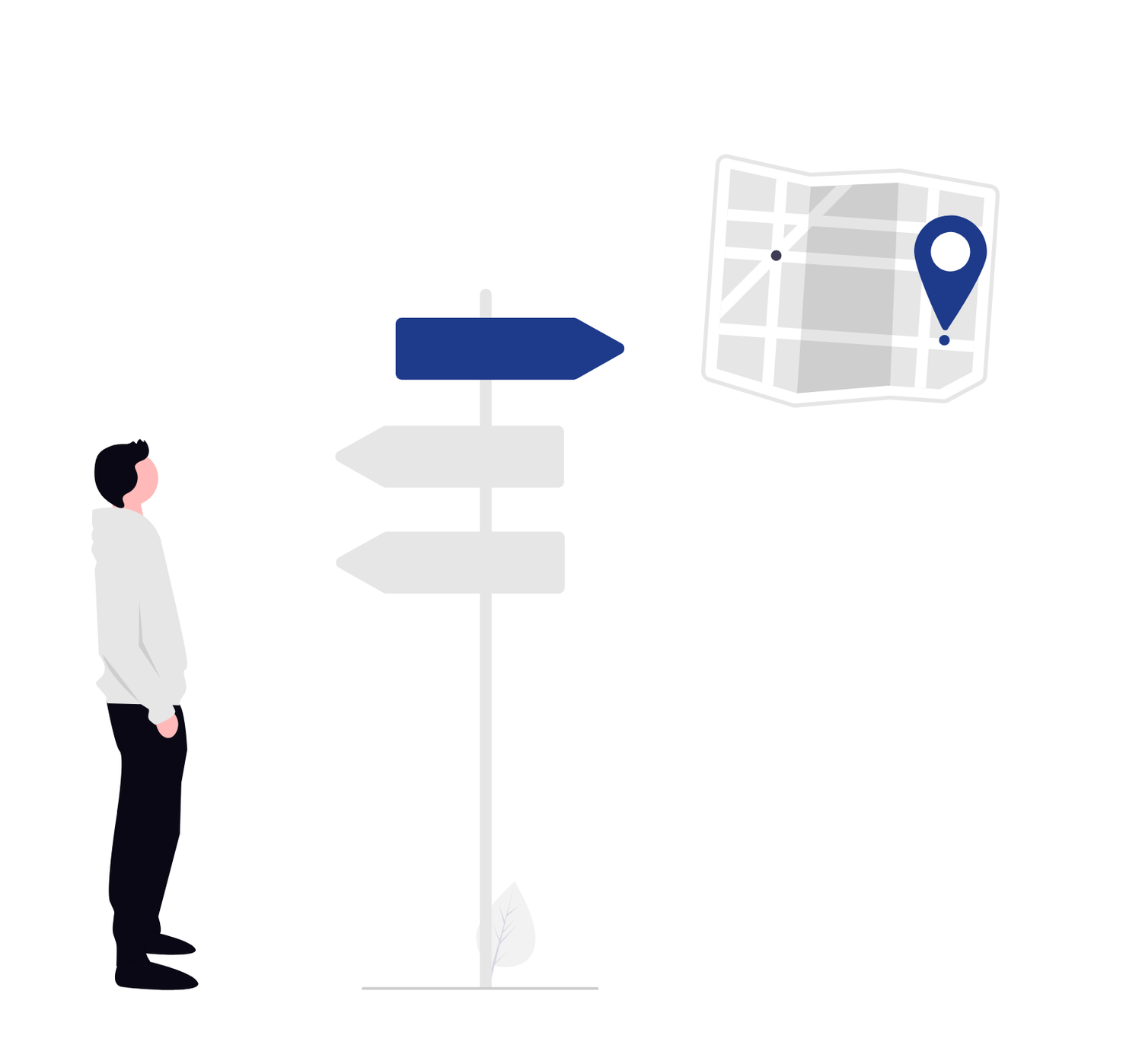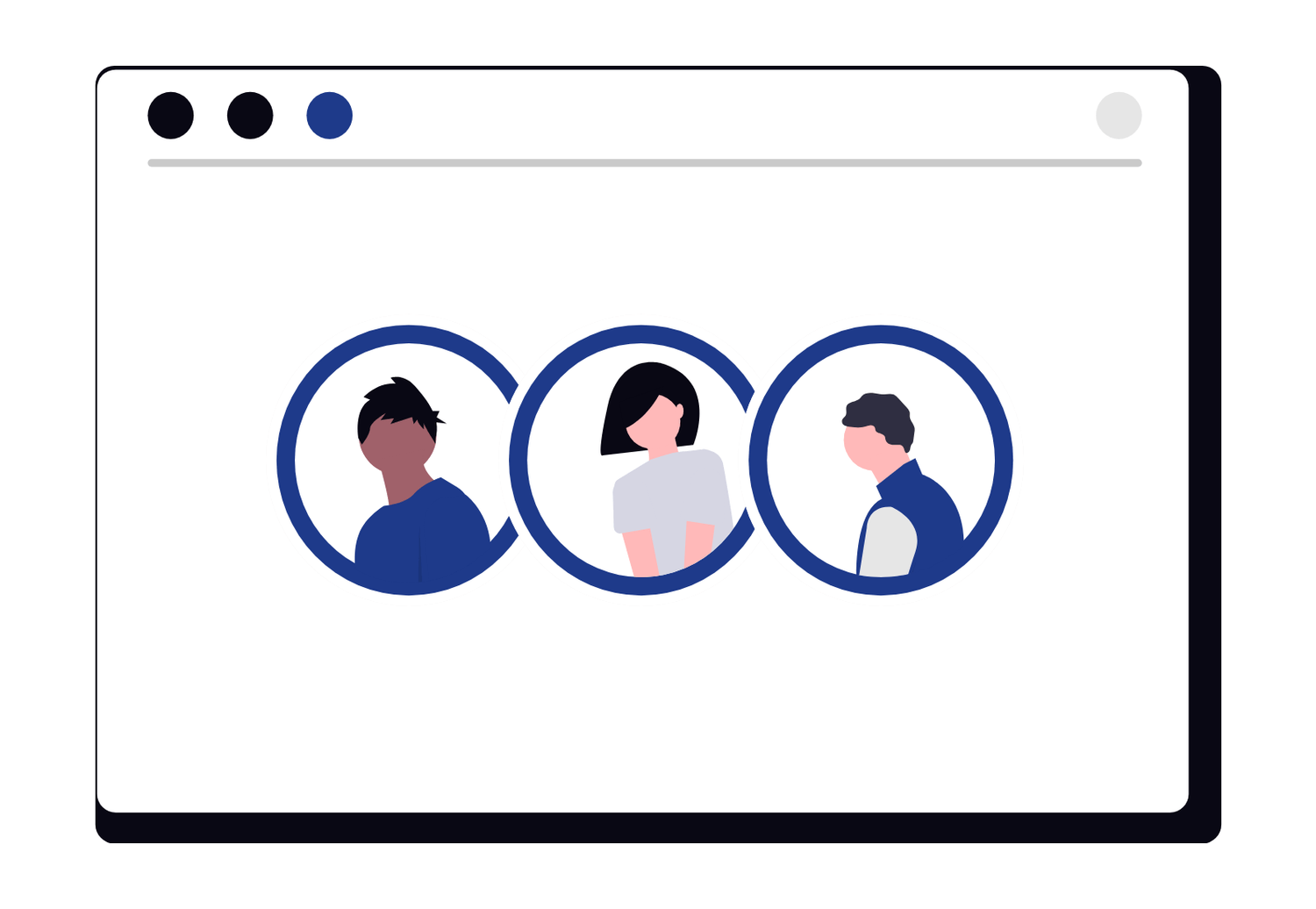Former les élus, un levier pour améliorer les conditions de travail des agents publics
Les élus locaux sont au cœur de l’action publique territoriale. Leurs décisions, leur posture, leur manière de collaborer influencent directement le quotidien des agents publics. Pourtant, la question de leur formation reste marginale dans les débats. Dans cet épisode, Aurélie Dolé partage son expérience d’agente territoriale confrontée à des attentes floues ou mouvantes. Elle propose un éclairage nuancé : former les élus, non pour les professionnaliser au sens technocratique, mais pour permettre une relation de travail plus claire, plus respectueuse et plus soutenable pour les équipes.
Présentation de l'invité : Aurélie Dolé
« Quand les élus ne savent pas ce qu’ils peuvent faire, ils attendent parfois des agents qu’ils fassent tout. »
Aurélie Dolé a longtemps été DGS dans une commune rurale. C’est dans ce contexte qu’elle a pris la mesure de ce que la formation — ou l’absence de formation — des élus change dans les relations de travail. Son témoignage met en lumière les zones d’inconfort que peuvent vivre les agents, mais aussi les marges de progrès possibles pour construire un meilleur dialogue entre élus et fonctionnaires.
Décryptage des idées clés
Mieux former les élus, c’est réduire la charge mentale des agents
Quand les élus comprennent la réalité du fonctionnement administratif, le travail des agents devient plus fluide, plus cohérent et moins conflictuel. Beaucoup de tensions viennent d’un malentendu : les élus pensent parfois que tout est possible, sans mesurer les contraintes juridiques, budgétaires ou humaines. Former les élus, c’est leur donner les clés pour décider en conscience et non par réflexe.
Cela change tout pour les agents : moins de pression absurde, moins d’ordres contradictoires, plus de cohérence dans les priorités. Cette montée en compétence politique améliore directement les conditions de travail, car elle remet chacun à sa juste place : l’élu oriente, l’agent met en œuvre. La formation devient un acte de respect mutuel.
Former les élus, c’est aussi protéger les équipes
Les élus formés comprennent mieux les impacts humains de leurs décisions : réorganisations, budgets, recrutements, communication interne… Cette conscience limite les décisions précipitées et les injonctions paradoxales. Pour les agents, cela se traduit par un climat de confiance : les objectifs sont plus réalistes, les priorités plus lisibles, et la reconnaissance du travail plus explicite.
La formation permet aussi aux élus de découvrir la richesse des métiers publics, leurs logiques et leurs contraintes. En formant les élus, on protège donc les équipes, on sécurise les relations hiérarchiques et on donne de la dignité au quotidien professionnel des agents. C’est une forme de prévention du stress institutionnel.
Une culture commune : le meilleur levier de coopération
La formation ne sert pas seulement à transmettre des savoirs, mais à créer un langage commun entre élus et agents. Quand les deux comprennent les règles du jeu, les marges de manœuvre et les temporalités de chacun, la coopération devient naturelle. Les agents cessent d’avoir le rôle du “frein administratif” et peuvent redevenir force de proposition. En face, les élus gagnent en lucidité et en crédibilité.
Cette culture partagée nourrit un cercle vertueux : décisions plus justes, relations apaisées, meilleure qualité de service… et surtout, plus de fierté collective. Former les élus, c’est en réalité renforcer la puissance d’agir de toute la fonction publique.
© 2025 Fonction Publique Mon Amour