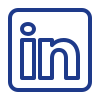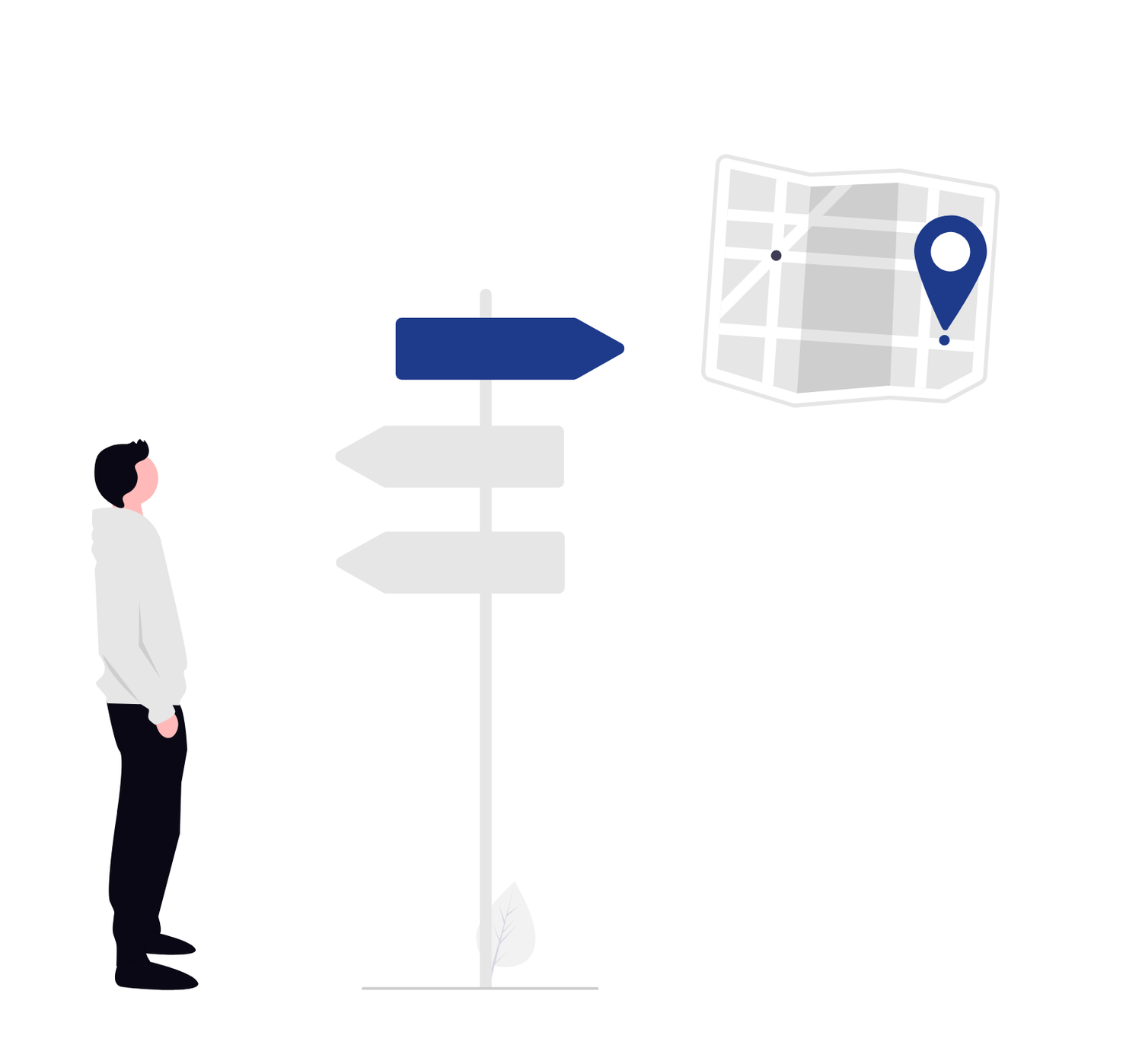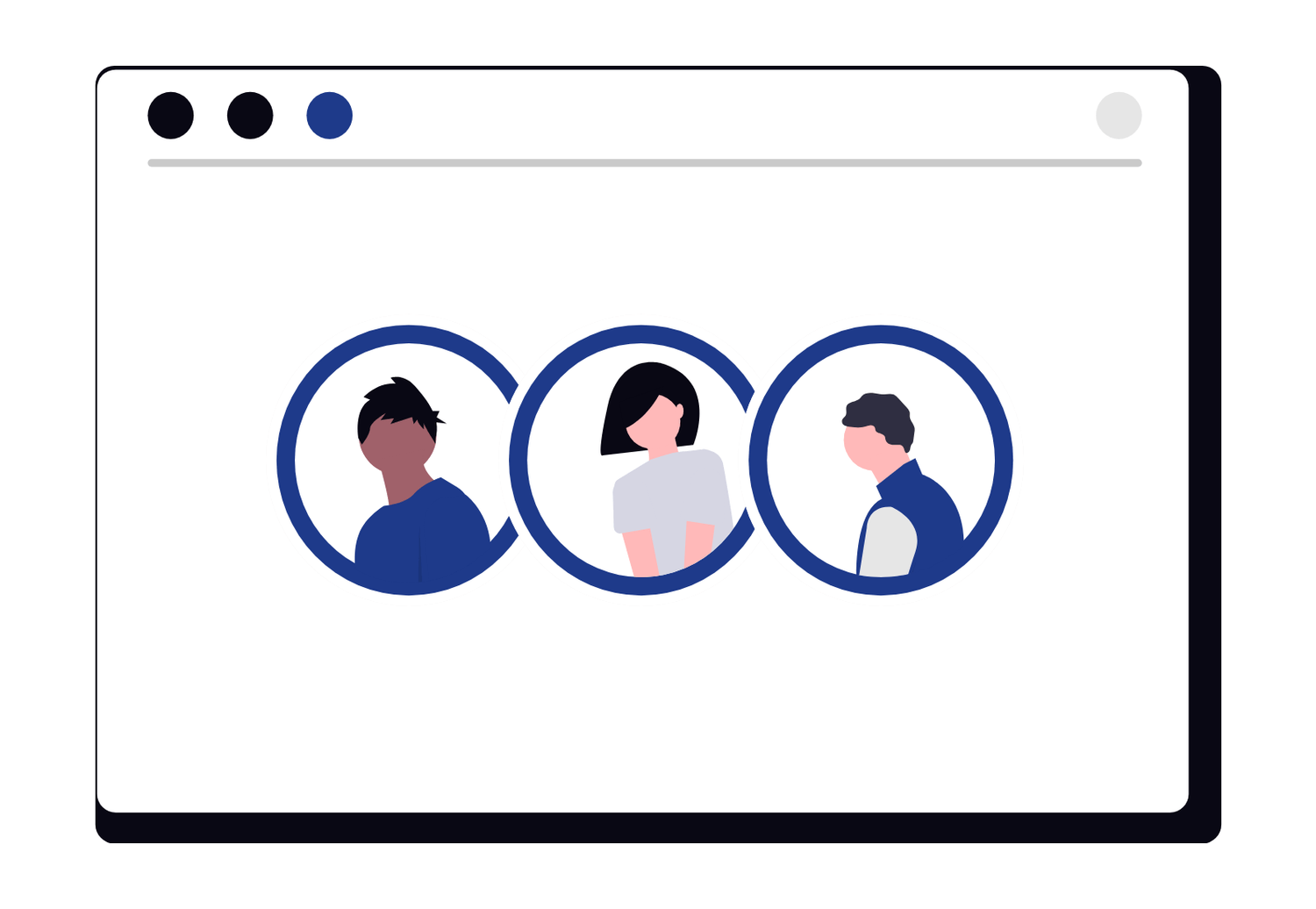Innover dans la fonction publique : à quel prix ?
On célèbre souvent les initiatives internes à l’État comme des signes d’agilité ou de transformation. Mais que se passe-t-il lorsqu’un agent public, sans quitter sa mission, décide de porter un projet innovant de bout en bout ?
Cet épisode donne la parole à Sabine Marini, fonctionnaire à la DDTM des Bouches-du-Rhône, qui a mené pendant quatre ans un projet d’intrapreneuriat. Une démarche fondée sur le sens du service et l’intelligence du terrain.
Cet échange offre un regard sincère sur les marges de manœuvre – et les limites – de l’innovation dans la fonction publique.
« Intrapreneur, c’est donner son temps, son énergie, son cerveau… pour un projet qui ne nous appartient pas. »
Fonctionnaire depuis plusieurs années, Sabine Marini travaille aujourd’hui à la DDTM des Bouches-du-Rhône. Entre 2021 et 2024, elle a été intrapreneure publique sur le projet APiLos : le portail du conventionnement APL.
Un engagement parallèle à son poste, mené sans rémunération supplémentaire, et qui interroge les conditions réelles de reconnaissance dans la fonction publique.
Décryptage des idées clés
Innover, c’est s’engager au-delà de sa mission
Innover dans la fonction publique, ce n’est pas seulement avoir une idée : c’est choisir d’agir autrement, souvent sans cadre, sans garantie ni reconnaissance immédiate. L’innovation naît rarement d’un appel à projets. Elle émerge quand des agents, confrontés à des blocages quotidiens, décident de chercher une autre voie.
Cet engagement dépasse la fiche de poste. Il suppose du temps, de l’énergie et une certaine audace : aller convaincre, bricoler, tester, échouer, recommencer. C’est une prise de risque professionnelle et personnelle.
Mais cette énergie a un coût : celui du déséquilibre entre la mission officielle et la mission vécue. Tant que l’organisation ne reconnaîtra pas cet effort supplémentaire, elle continuera à dépendre de la motivation individuelle de quelques-uns plutôt que d’une véritable culture collective de l’innovation.
Deux cultures du travail qui peinent encore à se comprendre
Dans la fonction publique, deux mondes cohabitent sans toujours se rencontrer. D’un côté, les innovateurs, souvent animés par la logique du test, du prototype, du “on essaye et on verra”. De l’autre, les structures hiérarchiques, attachées à la procédure, à la conformité, à la sécurité juridique.
Ces deux approches ne sont pas incompatibles : elles servent des besoins différents. Mais faute d’espaces communs, elles s’ignorent et finissent par se méfier. Les intrapreneurs publics se sentent isolés ; les encadrants, eux, redoutent la désorganisation.
L’enjeu est donc de créer une interface entre ces deux logiques. Reconnaître que la rigueur peut cohabiter avec l’expérimentation, que la conformité peut intégrer le changement. Sans ce dialogue, l’innovation restera périphérique, portée par des individus plutôt que par le système dans son ensemble.
Reconnaître et soutenir celles et ceux qui prennent le risque d’innover
Ce qui manque le plus aux innovateurs publics, ce n’est pas la motivation, mais la reconnaissance. Les dispositifs existent, les labels aussi, mais ils ne suffisent pas à compenser l’investissement réel des agents.
L’innovation ne doit pas être un acte militant. Elle devrait faire partie du fonctionnement normal du service public, avec un cadre clair de soutien, de valorisation et de protection.
Cela passe par une reconnaissance institutionnelle — dans l’évaluation, la carrière, la formation — mais aussi par un accompagnement humain : permettre aux agents de se ressourcer, de partager leurs expériences, d’apprendre des échecs.
Tant que cet appui restera marginal, l’innovation restera coûteuse : en énergie, en temps, et parfois en désillusion. Pour qu’elle devienne une force durable, il faut que le collectif prenne le relais de l’initiative individuelle.
© 2025 Fonction Publique Mon Amour