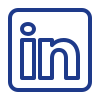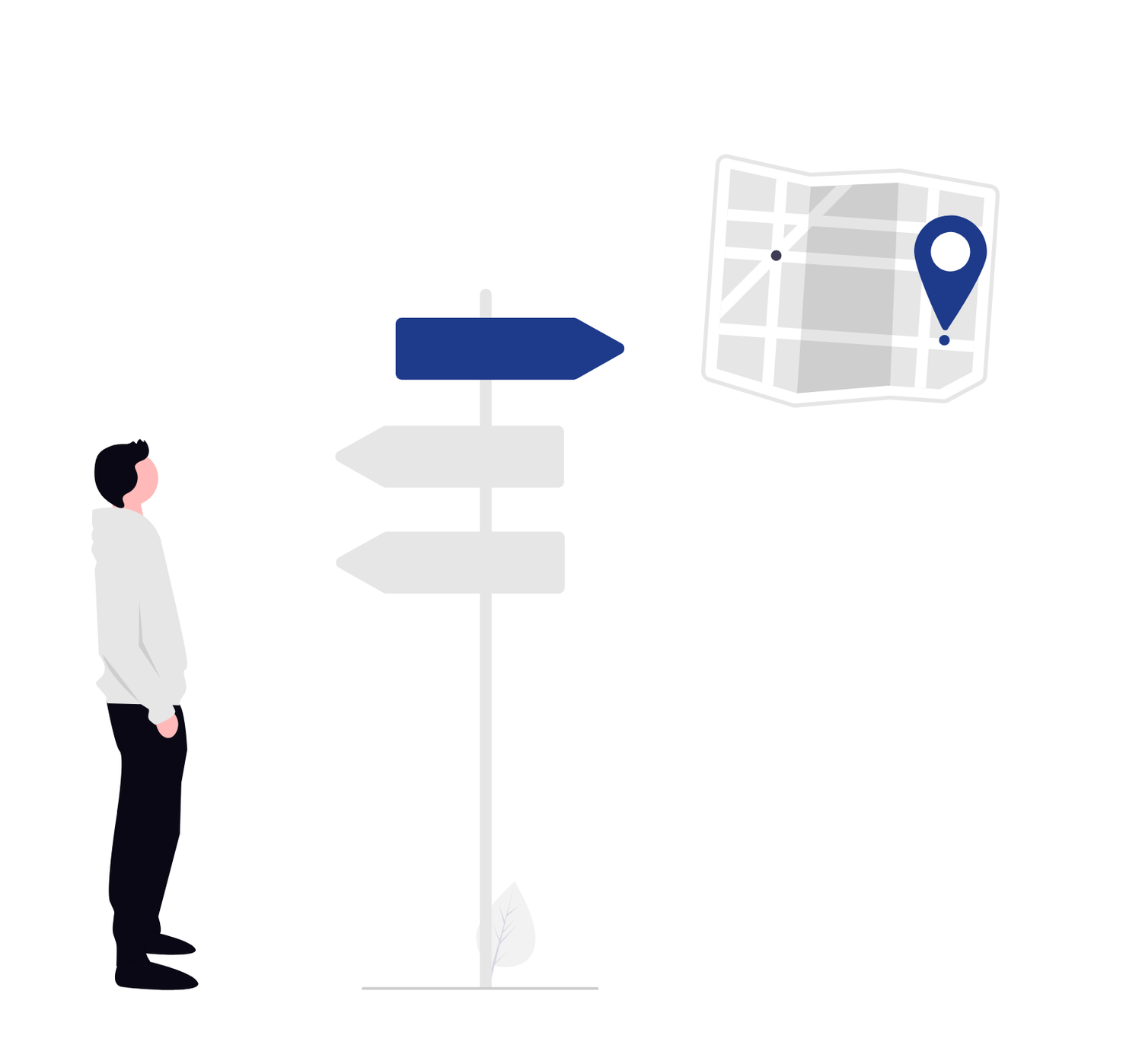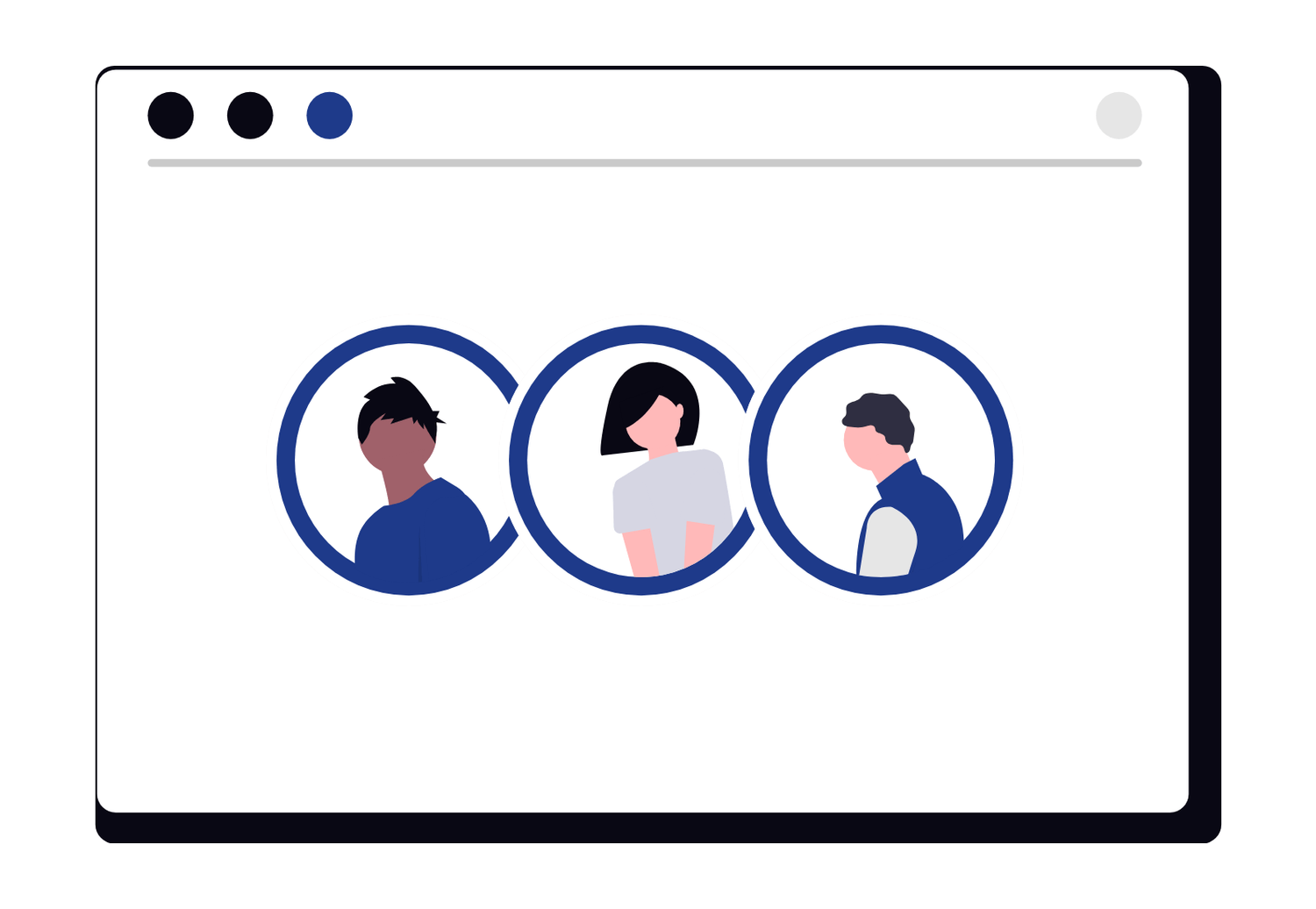Mobilité, égalité, recrutement : comment la fonction publique se transforme
Que signifie être DRH de l’État ? Avec 5,7 millions d’agents publics, les ressources humaines dans la fonction publique relèvent d’un exercice sans équivalent.
Dans cet épisode, Mathilde Icard revient sur son parcours et décrypte les grandes évolutions du métier RH dans la sphère publique. De la mobilité interversants à l’égalité professionnelle, en passant par l’adaptation à la crise sanitaire, elle partage une vision lucide, exigeante et incarnée du service public en transformation.
Présentation de l'invité : Mathilde Icard
« On ne gère pas 5,7 millions de personnes comme une entreprise. Il faut trouver de la souplesse dans la structure. »
Mathilde Icard est administratrice territoriale, issue de l’INET, avec près de vingt ans de parcours dans la fonction publique territoriale.
Depuis deux ans, elle occupe un poste de cheffe de service à la DGAFP, la direction qui pilote les ressources humaines de l’État et assure la cohérence des politiques RH à l’échelle interministérielle. Elle y défend une vision décloisonnée et exigeante de la gestion publique des agents.
Décryptage des idées clés
Faire de la mobilité un moteur d’apprentissage, pas une épreuve administrative
La mobilité dans la fonction publique reste souvent vécue comme une contrainte : démarches lourdes, perte de repères, sentiment de recommencer à zéro. Pourtant, elle peut devenir un formidable levier de développement professionnel si elle est accompagnée autrement.
La clé, c’est de passer d’une logique de procédure à une logique d’apprentissage. La mobilité ne se réduit pas à “changer de poste”, mais à faire évoluer ses compétences, ses pratiques et sa posture professionnelle. Elle ouvre la possibilité de croiser les cultures administratives, de comprendre d’autres métiers, d’élargir son regard sur le service public.
Cela suppose des outils RH plus souples, mais surtout une reconnaissance de la valeur de ces parcours : valoriser les passerelles, les retours d’expérience, les compétences transférables. La mobilité devient alors un acte de confiance dans la capacité de chacun à se réinventer au service du collectif.
L’égalité professionnelle comme levier de transformation réelle, pas seulement d’équité
L’égalité dans la fonction publique ne se résume pas à une question de chiffres ou de quotas. C’est un principe d’action qui oblige à revoir les modes de management, d’évaluation et de reconnaissance.
Promouvoir l’égalité, c’est questionner les pratiques quotidiennes : comment les décisions sont prises, qui a accès à la parole, à la responsabilité, au temps. Ce travail en profondeur transforme la culture professionnelle.
L’égalité femmes-hommes, notamment, ne progresse pas seulement grâce aux textes mais grâce aux pratiques locales : la vigilance sur les carrières, la lutte contre les biais, la reconnaissance des compétences relationnelles et transversales.
Lorsqu’elle est portée comme un enjeu collectif et non comme une contrainte réglementaire, l’égalité devient un puissant vecteur de modernisation. Elle ouvre la voie à un management plus juste, plus humain, et donc plus efficace dans la durée.
Recruter autrement pour refléter la société que la fonction publique sert
Le recrutement public évolue : nouveaux concours, attractivité des métiers, montée des compétences transversales. Mais la transformation ne sera réelle que si la fonction publique parvient à recruter différemment — en regardant au-delà des parcours types.
Il s’agit moins de trouver des “profils parfaits” que des personnes capables d’apprendre, de s’engager, de comprendre la diversité des publics servis. Cela suppose de repenser les critères de sélection, d’ouvrir les portes à des parcours variés, et de valoriser les compétences issues d’autres secteurs.
Recruter autrement, c’est aussi soigner l’accueil et l’intégration : créer les conditions pour que chacun trouve sa place, progresse et contribue. En assumant cette ouverture, la fonction publique renforce son rôle exemplaire : celui d’une organisation qui incarne la société qu’elle sert.
© 2025 Fonction Publique Mon Amour