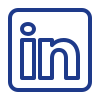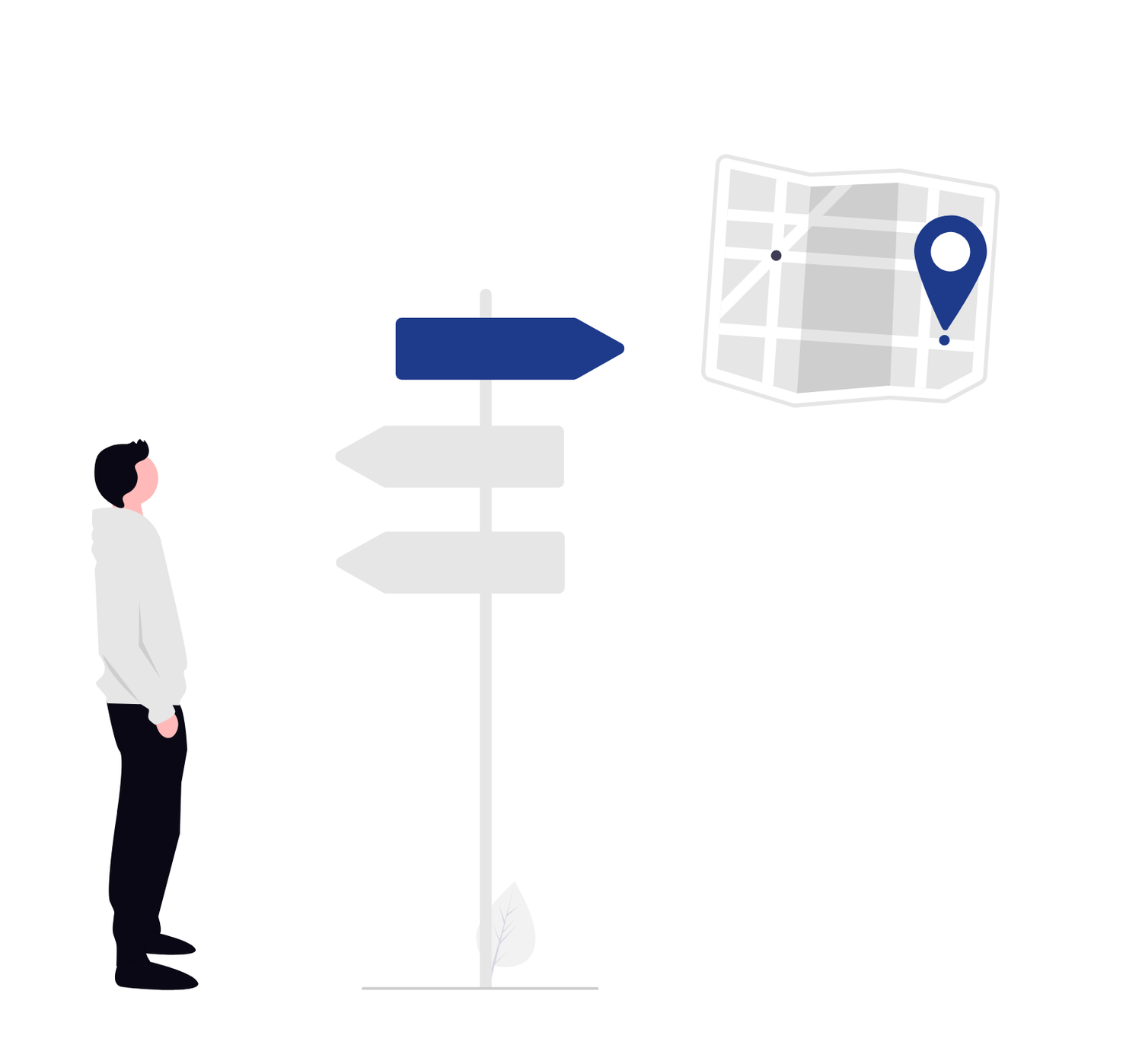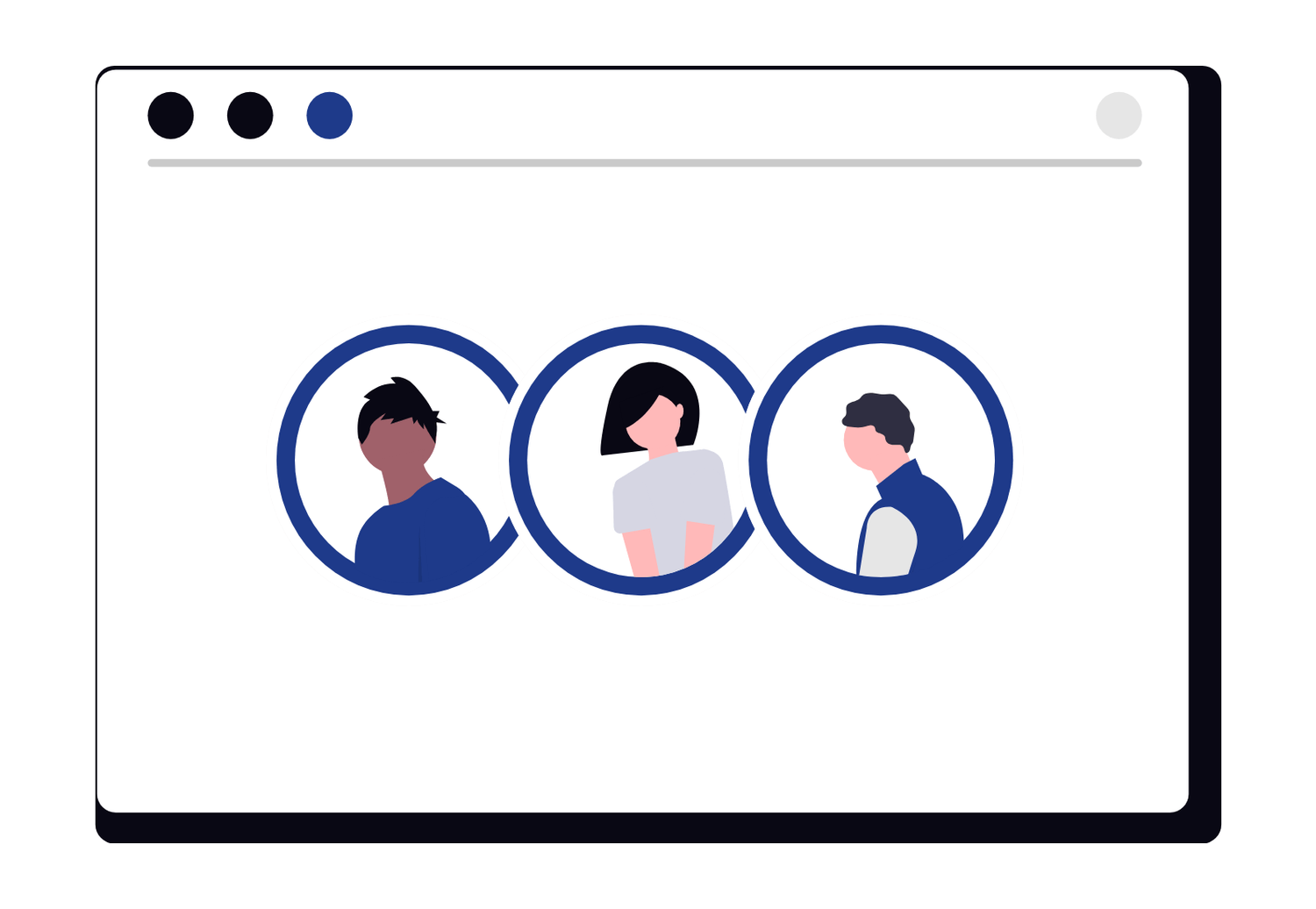Non, la complexité n’est pas une excuse : elle se pilote
La complexité dans les projets publics n’est pas un piège, c’est un terrain d’apprentissage.
Charlotte Dattée, experte des transformations publiques, partage une boîte à outils pensée pour celles et ceux qui affrontent l’incertitude du réel.
Poser un cadre clair, créer les conditions d’une coopération sincère, accepter le mouvement sans s’y perdre : trois leviers essentiels pour piloter autrement, avec lucidité et confiance.
Présentation de l'invité : Charlotte Dattée
« On ne gère pas un projet complexe avec des recettes simples. On avance avec une boussole, pas avec une carte. »
Charlotte Dattée est fondatrice de Fluidivance, cabinet qui accompagne les organisations publiques et leurs équipes dans les transformations complexes. Ancienne cheffe de mission à la Direction interministérielle du numérique (DINUM), elle a conçu et piloté des projets stratégiques liés aux talents, à la coopération et à l’innovation dans l’action publique.
Elle partage ici une lecture pratique et humaine de la complexité, forgée au cœur des administrations.
Décryptage des idées clés
Comprendre la complexité : un système vivant, pas une machine à gérer
Un projet complexe n’est pas un problème à résoudre mais un écosystème à comprendre. Il ne s’agit pas seulement d’empiler des tâches, mais de composer avec des interactions multiples, mouvantes et souvent imprévisibles. La complexité ne vient pas de la taille du projet mais de la diversité des acteurs, des logiques et des temporalités.
Vouloir tout anticiper, c’est souvent stérile : on ne maîtrise pas le réel par excès de planification. L’enjeu devient alors d’accepter l’incertitude, de construire du sens commun, et de donner des repères plutôt que des ordres. C’est une manière plus organique de piloter, où la confiance et l’intelligence collective remplacent le contrôle permanent. Dans ce cadre, la réussite se mesure moins à la conformité au plan qu’à la capacité d’adaptation.
Le cadre comme boussole : stabilité et souplesse à la fois
Les projets complexes exigent un cadre solide mais respirant. Trop rigide, il fige l’action ; trop flou, il dissout les responsabilités. Le cadre, ici, ne se résume pas à une procédure administrative mais à un langage partagé, une architecture de sens. Il dit ce qui est non négociable — valeurs, finalités, objectifs structurants — et laisse de l’espace à la créativité et à la réactivité.
Cette approche permet aux équipes de se situer, d’agir de manière autonome tout en restant alignées. Le cadre devient une boussole commune, non un carcan. C’est lui qui permet d’évoluer dans le changement sans se perdre, de maintenir une cohérence dans un environnement qui bouge sans cesse. En somme, il structure la liberté d’action plutôt qu’il ne la contraint.
Gouvernance claire et mandatement explicite : conditions de réussite
La complexité n’exclut pas la clarté. Pour tenir dans la durée, un projet doit être porté par une gouvernance identifiée et incarnée. Mandater officiellement un chef de projet, définir un objectif, un délai et des moyens — ce fameux triptyque coût-délai-qualité — crée un socle de responsabilité partagée. Sans cela, tout se dilue dans l’entre-deux hiérarchique. La gouvernance doit être transverse, capable d’arbitrer rapidement, de coordonner les énergies et de protéger le projet des inerties organisationnelles.
C’est aussi une manière d’instaurer une culture de confiance : chacun sait à qui il rend compte, dans quel cadre et avec quelle latitude. La formalisation n’est donc pas bureaucratique ; elle est la condition même de la coopération dans un environnement mouvant.
© 2025 Fonction Publique Mon Amour