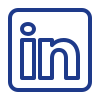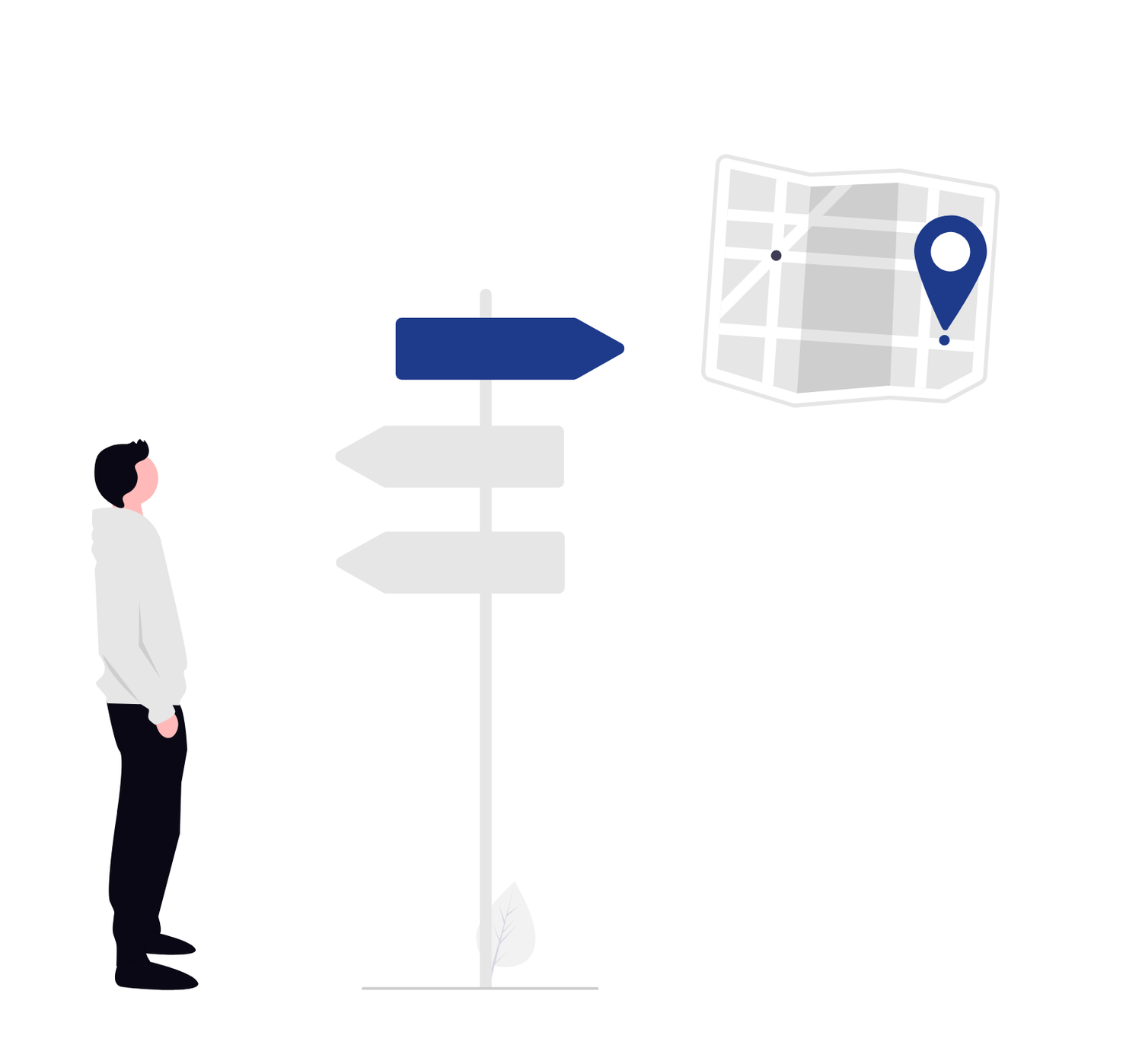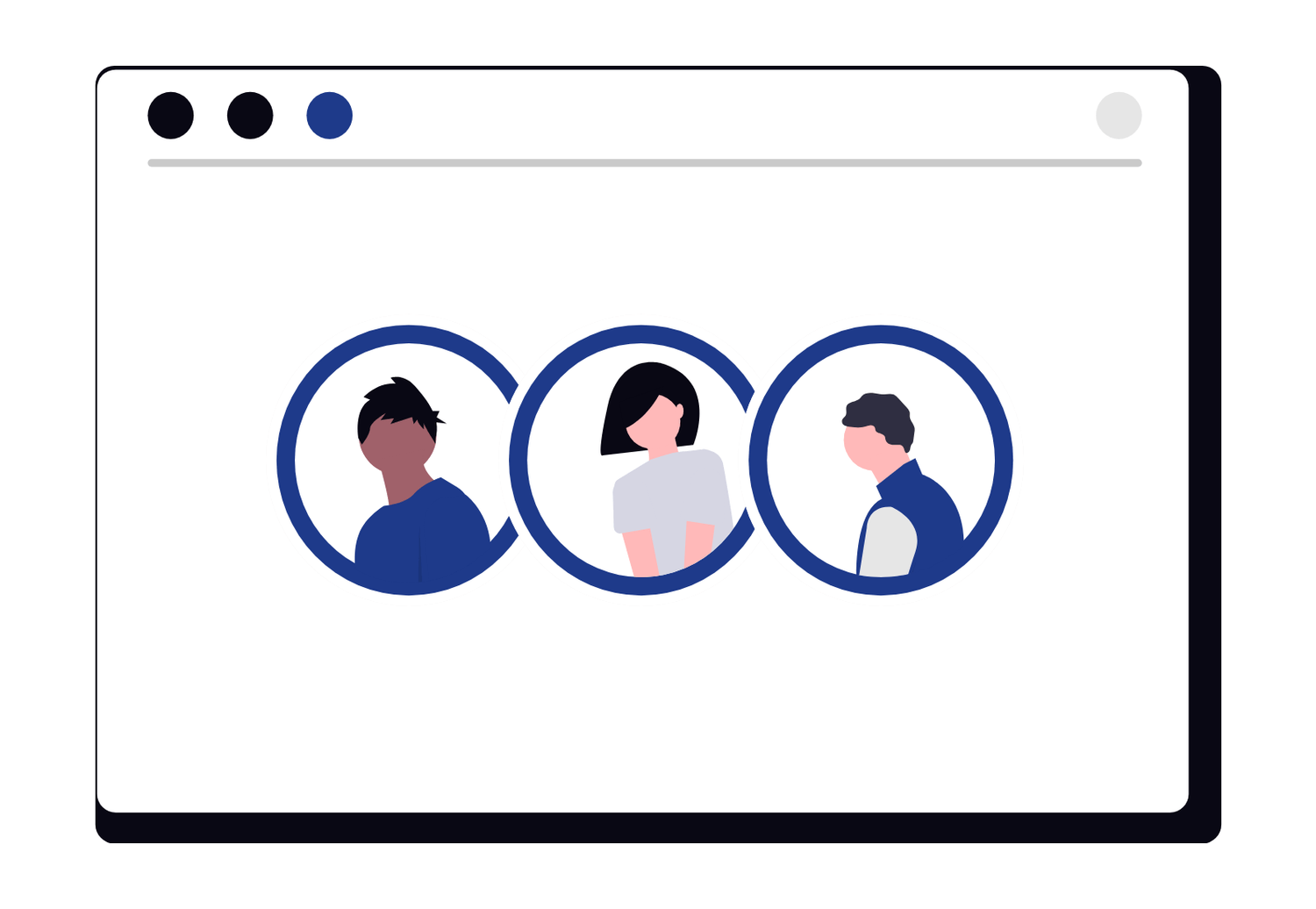Le tabou de l'incompétence : ce que la fonction publique n'ose pas se dire
"Je suis dirigée par un incompétent, mon manager est incompétent, je ne comprends pas comment il y a autant d'incompétence dans ma gouvernance."
Isabelle, enseignante-chercheuse, a entendu cette phrase des dizaines de fois pendant trois ans d'enquête. Elle l'a popularisé sous un terme grec : la kakistocratie, le pouvoir des pires.
Un tabou profond qui traverse toute la fonction publique, et que personne n'ose vraiment nommer.
Présentation de l'invité : Isabelle Barth
« Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui disait "je suis incompétent et je suis au pouvoir". »
Isabelle Barth est professeure des universités en sciences de gestion, chercheuse et autrice de "La Kakistocratie ou le pouvoir des pires".
Ancienne directrice de l’École de management de Strasbourg, elle interroge depuis des années les dérives du leadership et les impensés du management, dans le public comme dans le privé.
Décryptage des idées clés
L’incompétence n’est pas un accident, c’est un système
Il y a des mots qui dérangent, parce qu’ils touchent juste. Kakistocratie fait partie de ceux-là : le pouvoir des pires, non pas par malveillance, mais par inertie. Dans bien des administrations, l’incompétence ne naît pas d’un manque de volonté. Elle s’installe doucement, protégée par la loyauté, les habitudes, la peur du conflit.
Celui ou celle qui ne fait pas de vagues devient plus rassurant qu’un esprit exigeant ou critique. On préfère la docilité à la confrontation, la continuité à la remise en question. Et quand le système ne connaît pas de sanction directe – pas de faillite, pas de perte de clients – il peut continuer à tourner, même mal huilé. Le vrai tabou est là : admettre que certaines organisations fonctionnent non pas malgré l’incompétence, mais avec elle.
La question devient alors politique : comment créer un environnement où la compétence est valorisée, encouragée, protégée ? Où l’on préfère la qualité du travail à la tranquillité hiérarchique ?
Le concours fabrique des sachants, pas toujours des agissants
Le concours est l’un des piliers de la fonction publique : il garantit l’égalité d’accès, la neutralité du recrutement, la reconnaissance du savoir. Mais il a un effet secondaire souvent passé sous silence : il fabrique des sachants, pas forcément des agissants. On y apprend à réciter, pas à décider ; à démontrer sa mémoire, pas son discernement.
Ce modèle a produit des générations de professionnels brillants sur le plan théorique, mais parfois démunis face à la complexité humaine du terrain. Le management public en souffre : on dirige avec des concepts, pas toujours avec des corps et des émotions. Les épreuves du concours devraient évoluer, non pour abaisser le niveau, mais pour reconnaître d’autres formes d’intelligence : relationnelle, collective, pragmatique. Celles qui permettent de coopérer, de comprendre les besoins des équipes, de gérer le réel plutôt que l’abstraction.
Repenser le recrutement, c’est redonner du souffle à la fonction publique, en rappelant que la compétence ne se prouve pas seulement dans un écrit, mais dans la capacité à faire avancer un collectif.
Réhabiliter la compétence, c’est aussi réhabiliter le courage
Derrière le tabou de l’incompétence se cache souvent une peur : celle de nommer les choses. Dire qu’un poste n’est pas bien occupé, qu’un service tourne en rond, qu’un manager n’a pas les clés de sa fonction, c’est prendre un risque. Celui d’être jugé, isolé, mal vu.
Et pourtant, la compétence n’existe pas sans courage : courage de se former, de se confronter au réel, de demander de l’aide, de reconnaître ses limites. La fonction publique a besoin de ces espaces de vérité où l’on peut parler sans crainte de la qualité du travail, des erreurs, des apprentissages. Sortir du non-dit, c’est réhabiliter l’idée même de progression.
Ce n’est pas un procès contre les individus, mais un engagement collectif pour la lucidité : oser dire quand ça ne va pas, oser faire bouger ce qui doit l’être. Le courage managérial est la première forme de compétence partagée ; il ouvre la voie à un service public plus juste, plus vivant, plus intelligent.
© 2025 Fonction Publique Mon Amour