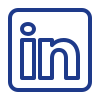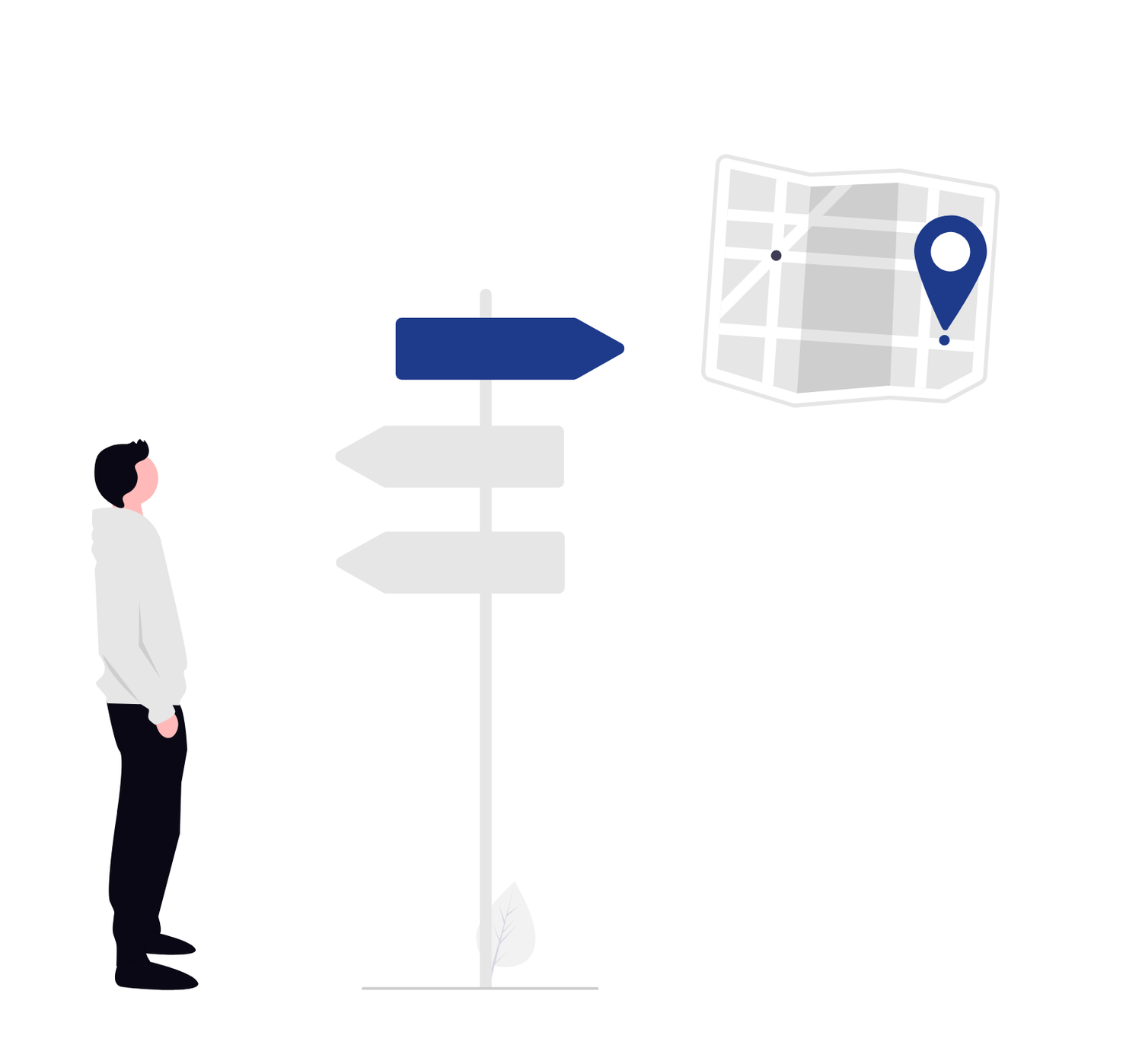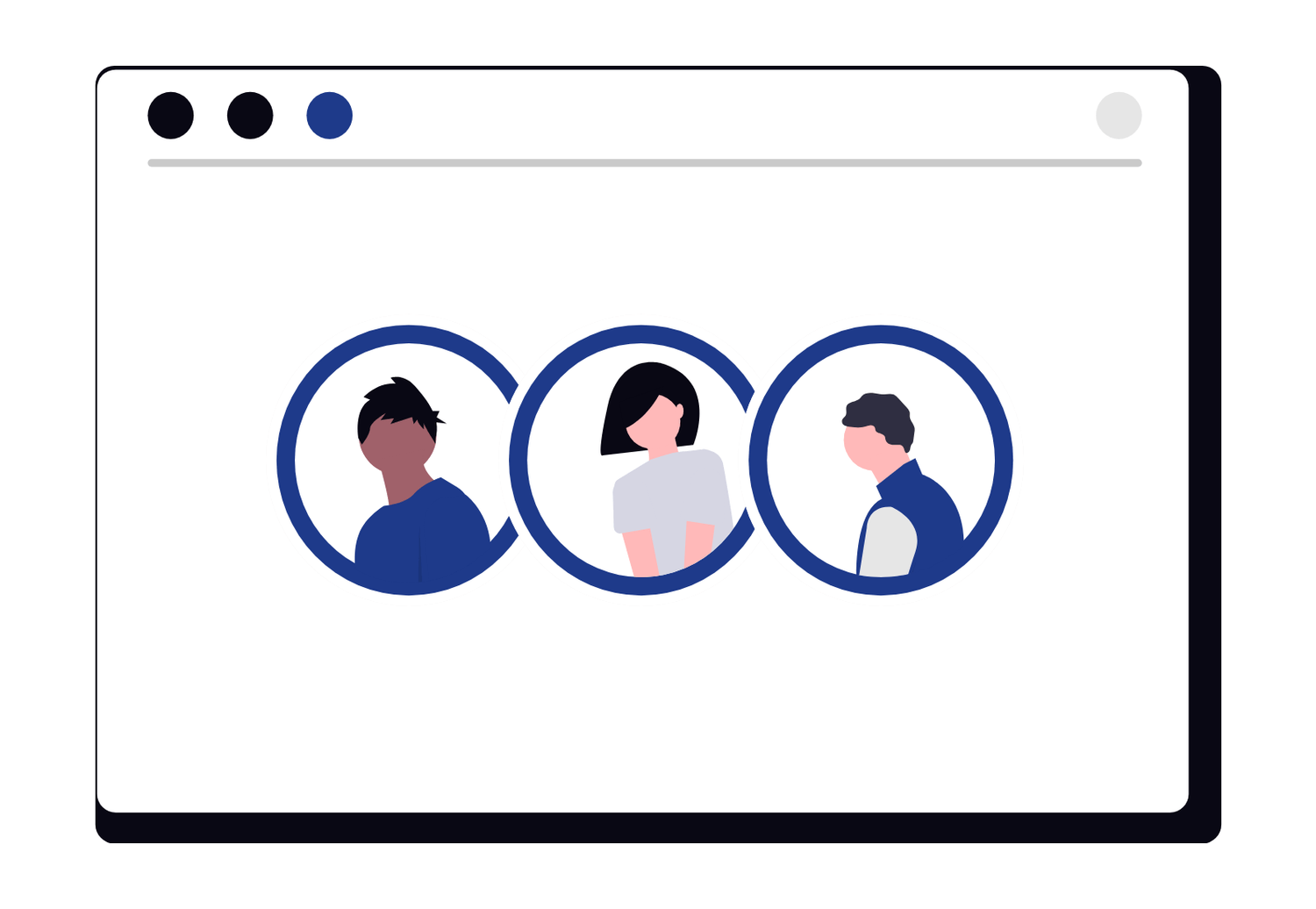Ce n’est pas une guerre des générations, c’est un manque de conversation
On parle souvent de “guerre des générations” dans la fonction publique. Mais pour Élodie Gentina, chercheuse et autrice, cette guerre n’existe pas : c’est le manque de conversation qui creuse les fossés.
Plutôt que d’opposer les âges, elle invite à recréer du dialogue, de la curiosité et du sens partagé au cœur des équipes publiques.
Présentation de l'invité : Élodie Gentina
« La transmission n’est plus à sens unique : les plus jeunes aussi ont des choses à apprendre aux plus expérimentés. »
Élodie Gentina est enseignante-chercheuse à l’IÉSEG School of Management, spécialiste de la génération Z. Elle travaille depuis plus de dix ans sur les comportements, les attentes et les rapports au travail de cette génération.
Elle est l’autrice de plusieurs ouvrages dont "Le défi du management intergénérationnel" (Dunod) et intervient régulièrement auprès des organisations publiques et privées pour les aider à mieux comprendre les jeunes talents.
Décryptage des idées clés
Sortir du mythe du "choc des générations"
Parler de “choc des générations” enferme les équipes dans des cases qui ne reflètent pas la réalité du travail. Ce n’est pas l’âge qui sépare, mais l’absence de conversation.
Dans les services, les générations cohabitent, souvent sans se parler vraiment de leurs attentes, de leurs manières de faire ou de leurs contraintes. Les plus jeunes cherchent du sens et du dialogue, les plus expérimentés veulent être reconnus pour leur expérience.
Ces besoins ne s’opposent pas : ils se complètent. Le management intergénérationnel consiste à recréer du lien entre ces univers. Il ne s’agit pas de gommer les différences, mais d’apprendre à les traduire. C’est dans cet espace d’écoute que se reconstruit la confiance collective et que chacun peut retrouver la fierté de contribuer.
De la flexibilité, pas du désengagement
La jeune génération ne réclame pas moins de travail, mais plus de liberté pour bien le faire. Elle ne rejette pas la présence au bureau, elle souhaite davantage de flexibilité dans les horaires, les rythmes, les modes d’organisation.
Cette demande n’est pas une rupture avec la culture de la sphère publique, mais une manière d’y réinjecter de la confiance et de la responsabilité. La flexibilité n’est pas le contraire de l’engagement : elle en est souvent la condition. Quand les équipes peuvent adapter leur manière de travailler, elles se sentent reconnues et plus utiles.
Cette approche suppose un management fondé sur la clarté des objectifs et non sur le contrôle permanent.
La transmission, une route à double sens
La transmission ne va plus d’un ancien vers un jeune, elle circule dans les deux sens. L’expérience et la mémoire des agents de longue date sont essentielles, tout comme la fraîcheur et la maîtrise des nouveaux outils apportées par les plus jeunes.
Dans la fonction publique, cette complémentarité peut devenir une véritable force si elle est organisée et valorisée. Le mentorat croisé, les binômes intergénérationnels ou la co-construction de projets permettent de faire circuler les savoirs et de renforcer la cohésion.
La transmission devient un espace de reconnaissance mutuelle où chacun apprend de l’autre. C’est ainsi que se maintient la continuité du service public, au-delà des générations.
© 2025 Fonction Publique Mon Amour