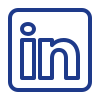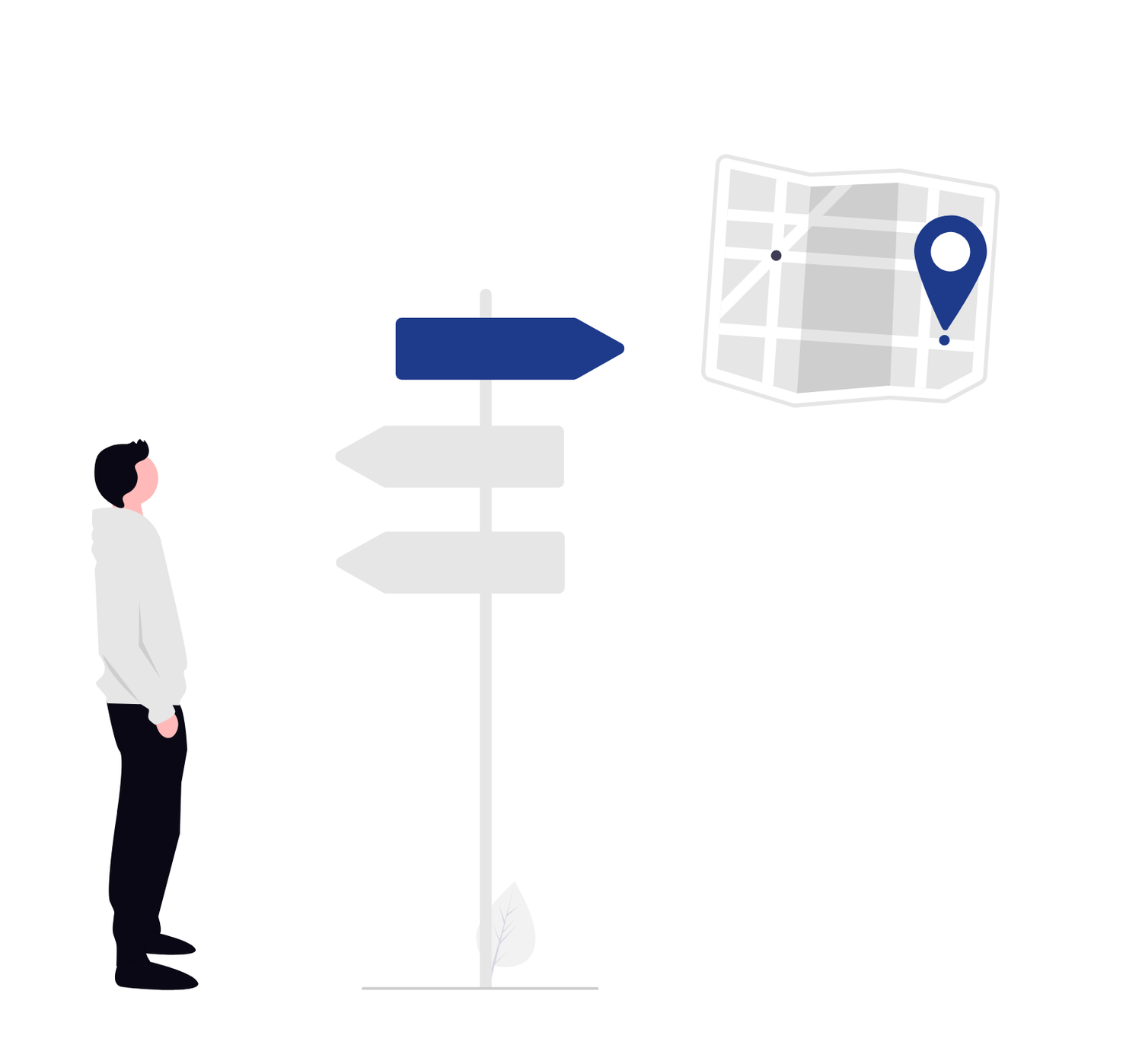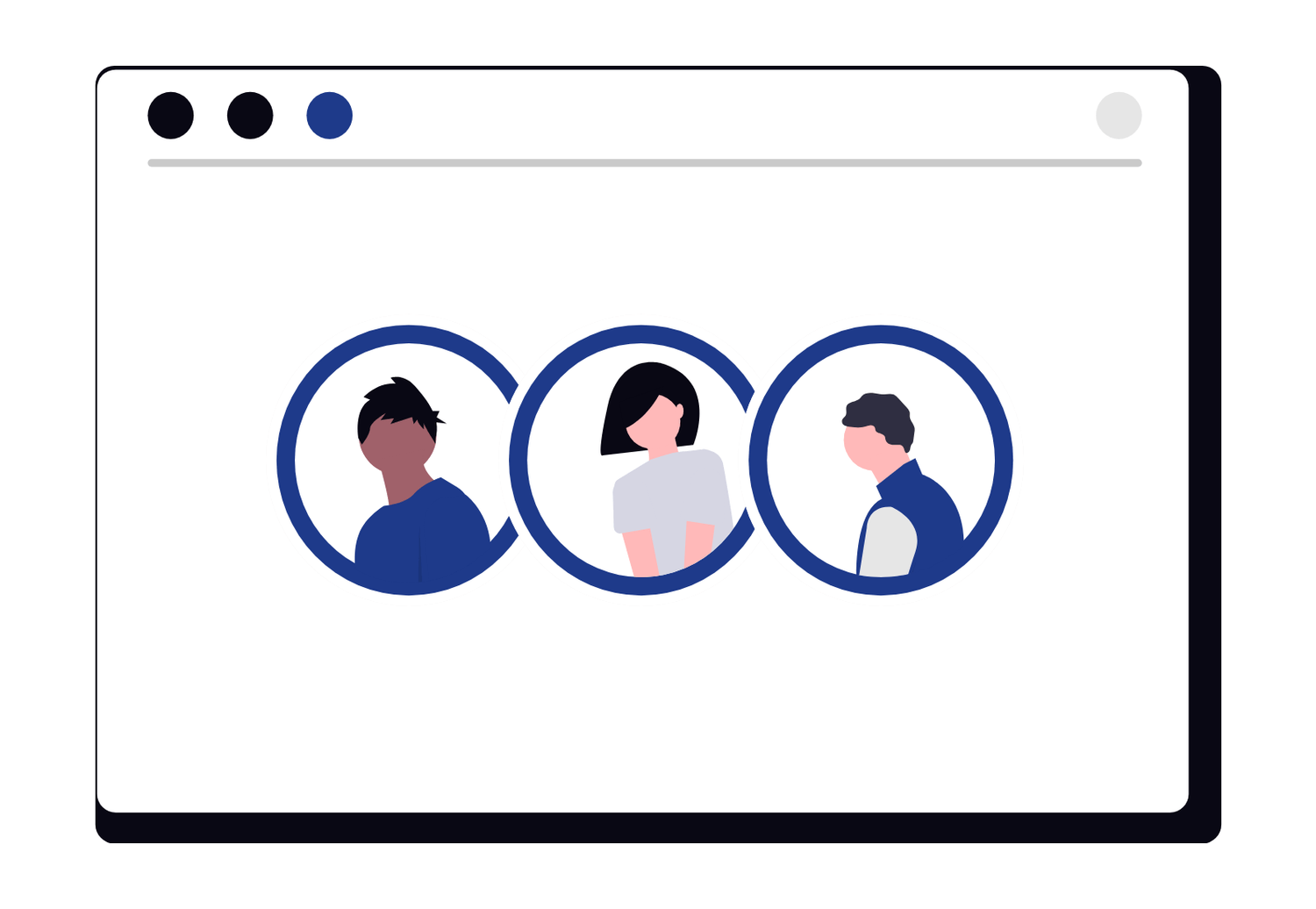Non, une réunion bien animée n’est pas de l’intelligence collective
Tout le monde parle d’intelligence collective, mais peu savent vraiment ce que cela implique.
Charlotte Dattée, experte des transformations publiques, distingue ici la coopération authentique du simple travail en groupe. L’intelligence collective n’est ni un atelier post-it ni une réunion bien animée : c’est une exigence de clarté, d’écoute et de responsabilité partagée.
Une conversation pour comprendre comment créer, dans les organisations publiques, les conditions réelles du “faire ensemble”.
Présentation de l'invité : Charlotte Dattée
« Ce n’est pas le nombre de personnes autour de la table qui compte, c’est la qualité de ce qu’on fabrique ensemble. »
Charlotte Dattée est fondatrice de Fluidivance, cabinet qui accompagne les organisations publiques et leurs équipes dans les transformations complexes. Ancienne cheffe de mission à la Direction interministérielle du numérique (DINUM), elle a conçu et piloté des projets stratégiques liés aux talents, à la coopération et à l’innovation dans l’action publique.
Elle partage ici une lecture pratique et humaine de la complexité, forgée au cœur des administrations.
Décryptage des idées clés
L’intelligence collective ne se résume pas à l’animation
Une réunion fluide, un séminaire bien mené, des post-it partout : tout cela ne fait pas encore de l’intelligence collective. Ce qui la distingue, c’est l’intention et la responsabilité partagée. Il ne s’agit pas de “faire participer”, mais de “faire coopérer”. La différence est immense : la participation invite, la coopération engage.
L’intelligence collective se construit dans la durée. Elle suppose un cadre clair, un objectif commun, et surtout l’acceptation du désaccord. C’est un travail exigeant, parfois inconfortable, mais profondément fécond. Quand les organisations publiques s’y risquent vraiment, elles découvrent que la créativité ne naît pas du consensus, mais de la rencontre des points de vue.
Le cadre, condition de la confiance
Rien ne pousse dans le flou. L’intelligence collective a besoin d’un cadre solide, non pas pour contraindre, mais pour sécuriser. Ce cadre, c’est ce qui rend possible la parole vraie, la confrontation constructive, la prise d’initiative.
Dans la fonction publique, il agit comme un équilibre : il protège sans enfermer, oriente sans brider. Trop de cadre tue l’élan ; trop peu le fait déborder.
Le collectif, comme une rivière, a besoin de berges pour circuler. Le cadre donne ce sentiment de sécurité qui permet d’oser. Et c’est cette confiance-là — celle qu’on construit et non qu’on décrète — qui rend le collectif vraiment intelligent.
Du collectif à l’intelligence : une question de posture
L’intelligence collective n’est pas une méthode, c’est une posture. Elle naît de l’écoute sincère, de la curiosité, du courage de ne pas avoir raison seul.
Dans les projets publics, cela demande de ralentir, d’accueillir le flou sans paniquer, de faire de la place à l’imprévu.
Le rôle du manager ou du facilitateur n’est plus d’animer mais de soutenir la dynamique, de créer les conditions pour que le groupe fasse émerger sa propre solution.
C’est une autre manière d’exercer le pouvoir : non plus en décidant pour, mais en décidant avec. Là se joue sans doute la transformation la plus profonde de la fonction publique — celle qui relie l’intelligence à l’action.
© 2025 Fonction Publique Mon Amour